L’énergie éolienne
Régie par les codes de l’énergie, de l’environnement et de l’urbanisme, un projet éolien en France doit veiller au respect d’un cadre règlementaire.
500 mètres
C’est la distance minimum légale entre une éolienne et une habitation.
30 à 40 dB
À 500 mètres de distance, une éolienne émet autant de bruit qu’un réfrigérateur.
La loi prévoit que le démontage du parc éolien et la remise en état du terrain soient systématiques et financés intégralement par l’entreprise.

L’impact des éoliennes sur la mortalité volatile est marginal, soit 850 fois moins que le trafic routier.
L’impact de l’éolien sur la valeur immobilière est comparable à celui d’une ligne à haute tension, soit de très faible à nul.
MÉTHODologie
Outre l’évaluation du potentiel éolien du site, le développement d’un projet intègre systématiquement l’inventaire et l’analyse des enjeux du territoire. Elles sont recensées au sein d’une étude d’impact et font état de l’environnement sonore, de la biodiversité, du patrimoine local, etc …
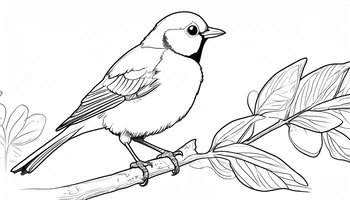 Pour chaque projet éolien, une étude d’impact analyse les effets potentiels sur l’avifaune et sur la flore à proximité et sur le site envisagé. Sur la base d’inventaires réalisés par des écologues sur les 4 saisons, une analyse du comportement, des habitudes de déplacement, d’alimentation, du nombre d’individus, du type d’habitats permet de déterminer les impacts potentiels et de les éviter dans les propositions d’implantation des éoliennes envisagées.
Pour chaque projet éolien, une étude d’impact analyse les effets potentiels sur l’avifaune et sur la flore à proximité et sur le site envisagé. Sur la base d’inventaires réalisés par des écologues sur les 4 saisons, une analyse du comportement, des habitudes de déplacement, d’alimentation, du nombre d’individus, du type d’habitats permet de déterminer les impacts potentiels et de les éviter dans les propositions d’implantation des éoliennes envisagées.
Un parc éolien est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Il est donc soumis à une réglementation très stricte qui impose un suivi des éventuels effets du parc durant sa phase d’exploitation / de production.
Des mesures correctives peuvent être imposées le cas échéant (bridage des éoliennes).
 Les sites recherchés pour étudier la faisabilité d’un parc éolien doivent disposer de vents réguliers et suffisamment forts tout au long de l’année. Un mât de mesure est installé sur le site sur une période minimale d’une année. Équipé de girouettes et d’anémomètres, il permet de collecter les données sur l’orientation et la vitesse du vent. Celles-ci sont ensuite analysées et seront utiles pour définir :
Les sites recherchés pour étudier la faisabilité d’un parc éolien doivent disposer de vents réguliers et suffisamment forts tout au long de l’année. Un mât de mesure est installé sur le site sur une période minimale d’une année. Équipé de girouettes et d’anémomètres, il permet de collecter les données sur l’orientation et la vitesse du vent. Celles-ci sont ensuite analysées et seront utiles pour définir :
– Le nombre d’éoliennes envisageables
– Leur implantation
– Le choix du modèle des éoliennes

Le bruit se présente comme un sujet sensible dans le développement de projets éoliens. Ainsi, il est indispensable de réaliser une étude détaillé en amont, intégrant tous les aspects du projet et les différents éléments de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par arrêté du 10 décembre 2021 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Conformément à cette réglementation, l’étude acoustique va s’articuler autour des étapes suivantes :
• Campagnes de mesures in situ : détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du vent.
• Calculs prévisionnels du bruit des éoliennes : estimation de la contribution sonore du projet au droit des habitations riveraines.
• Analyse de l’émergence à partir des deux points précédents : validation du respect de la réglementation française en vigueur et, le cas échéant, proposition de solutions adaptées pour y parvenir.
La notion d’émergence est le pilier de la réglementation. Elle représente la différence entre le niveau de pression acoustique du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).
 La méthodologie mise en place dans le cadre de l’étude paysagère et patrimoniale a pour objectif d’identifier les différentes composantes du paysage, tout en proposant une analyse sensible du territoire, et de déterminer ses tendances d’évolution, puisque le paysage est, par définition, en constante évolution.
La méthodologie mise en place dans le cadre de l’étude paysagère et patrimoniale a pour objectif d’identifier les différentes composantes du paysage, tout en proposant une analyse sensible du territoire, et de déterminer ses tendances d’évolution, puisque le paysage est, par définition, en constante évolution.
L’étude s’appuie sur une approche thématique sur différentes échelles du territoire afin de hiérarchiser les sensibilités vis-à-vis de la Zone d’Implantation Potentielle. Les différentes composantes du territoire sont appréhendées item par item (lieux de vie, axes de communication, Monuments Historiques, etc.) afin de traiter chacun d’entre eux de façon précise et détaillée, et d’identifier de la sorte les principaux points de sensibilité potentielle par rapport au projet.
TECHNOLOGIE
Un parc éolien fonctionne par captation d’énergie : le vent fait tourner les pales des éoliennes qui transforment l’énergie mécanique en énergie électrique. Celle-ci est ensuite injectée sur le réseau électrique et distribuée aux consommateurs alentours. Ainsi, la production d’énergie électrique est renouvelable et non délocalisable à partir d’une ressource gratuite et inépuisable : le vent.
DÉMaNTÈleMENt / Repowering

La loi prévoit que le démontage du parc éolien et la remise en état du terrain soient systématiques et financés intégralement par l’entreprise.
Le repowering vise à remplacer l’ensemble des éoliennes par des machines plus performantes.
Voir l’arrêté du 22 juin 2020Depuis le 1er janvier 2024, + de 95 % d’une éolienne devra être recyclable ou réutilisable et ses différentes composantes prises en charge par des filières de revalorisation selon l’arrêté du 22 juin 2020. L’acier, le béton, le cuivre et l’aluminium sont 100 % recyclables.
en savoir + sur le recyclage
ÉNERGIE EN FRANCE
Dans l’objectif de sortir la France des énergies fossiles et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, RTE (Réseau de Transport d’Électricité) a mené une étude sur l’évolution du système électrique français de 2019 à 2022 intitulée « Futurs Énergétiques 2050 ». Cette étude a abouti à la réalisation de 6 scénarios prévisionnels fondés sur des enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et techniques. Quel que soit le scénario envisagé, l’atteinte de la neutralité carbone ne pourra être effective sans le développement significatif des énergies renouvelables.
Nos ressources
- Réseau de Transport d’Électricité (RTE) : gestionnaire du réseau de transport d’électricité français
- Ministères Aménagement du Territoire Transition Écologique
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
- Info Éolien : l’éolien en question
- Agence De la Transition Écologique (ADEME)

